Nous avons choisi de revenir sur ce livre de la sociologue de l’art Nathalie Heinich, une passionnante descente érudite dans les grands motifs et invariants des romans occidentaux, analysés comme miroirs de nos sociétés et de leurs rapports de force. Les états de femme
dans la littérature varient tous autour d’un pivot central, le couplage archaïque de la survie et du viol. Ce fonds culturel n’est pas sans effet dans la perception de la prostitution dans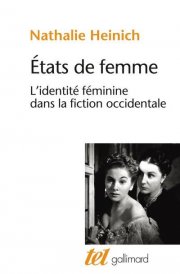 notre société et il nous invite, pensons-nous, à nous positionner de part et d’autre de la ligne de front : aménager ou mettre à bas l’ordre traditionnel ?
notre société et il nous invite, pensons-nous, à nous positionner de part et d’autre de la ligne de front : aménager ou mettre à bas l’ordre traditionnel ?
À quels rôles peuvent prétendre les femmes dans le miroir grossissant du roman ? Après avoir exploré les figures de la jeune fille à marier, de l’épouse, ainsi que de la maîtresse ou de la femme en secondes noces, puis plus tard les tierces
exclues du champ de la sexualité et au bord de la désocialisation (et de la défictionnalisation) que sont la veuve, la vieille fille ou la gouvernante, Nathalie Heinich décortique les multiples formes que prend la figure romanesque obsessionnelle de la prostituée. Courtisanes
de bas étage ou de haut vol, femme de mauvaise vie
ou entretenue
, débauchée
, grisette
, lorette
, fille perdue
, fille déchue
, fille des rues
… La prostituée se décline en mille noms aux facettes taillées par nos auteurs pour se loger dans des centaines de milliers de pages du patrimoine littéraire occidental.
Marginalisée, la prostituée ? Pas dans la littérature, à l’évidence – particulièrement la littérature masculine. Au contraire, souligne l’éminente sociologue de l’art, honnie ou sanctifiée la prostituée y est une figure centrale d’autant plus omniprésente qu’elle représente dans sa forme la plus exacerbée et transparente le statut commun imposé à toute femme par l’ordre traditionnel
gouverné par la loi du père
.
En effet, à l’instar de Fantine dansLes Misérables de Victor Hugo (1862) ou laNana d’Émile Zola (1880), si les différents avatars de la prostituée se retrouvent dans le même état premier
et ultime
d’avilissement aux mains et au sexe des hommes, à moins d’une intervention présentée comme miraculeuse d’un bourreau devenu sauveur [[Ainsi le cliché filmique dePretty Woman (1990) préexistait déjà en littérature, comme dansBéatrix de Honoré de Balzac (1839) où la courtisane Mme Schontz parvient à se faire épouser du marquis de Rochefide. C’est aussi ce qu’espère, en vain, du méprisant et égoïste Frédéric la pauvre Rosanette, bien qu’elle accouche de leur enfant qui meurt en bas âge, dansL’Éducation sentimentale de Flaubert (1869). Enfant vendue par sa mère pour être violée par un homme marié aux airs de dévot, elle tente de se noyer puis se prostitue pour survivre et payer ses dettes, tandis que les personnages masculins passent le roman à se partager cette femme comme un gâteau. Le mariage salvateur lui sera finalement proposé par le vieux M. Oudry, qui n’a pas sa préférence, mais qui a l’élégance de vite la laisser veuve.]], les différents états
de femme qu’éclairent le roman ne sont en définitive, selon Nathalie Heinich, que les différentes modalités d’une même condition. Celle-ci se caractérise par la liaison, rendue artificiellement inéluctable, entre subsistance et sexualité
. Là où l’épouse est réduite au statut d’outil de reproduction, la prostituée est réduite à son statut d’outil sexuel
. Aucune, finalement, n’a d’existence définie autrement que par le nom et l’argent que décident, ou non, de lui donner l’homme ou les hommes qui l’entourent, qui se l’approprient, l’achètent ou l’échangent en toute impunité.
Ainsi, par la contractualisation de leur soumission sexuelle en échange de moyens de survie de court ou de long termes, les personnages d’hommes avec lesquels toutes ces figures féminines pactisent s’assurent qu’elles renoncent à l’essentiel : renoncement à l’identité, à l’exigence d’être soi-même, autonome, particulière, insubstituable à aucune autre – une personne à part entière.
On dépasse de loin la question morale de la bonne
ou de la mauvaise
vie, qui est le cadre interprétatif généralement imposé par les romanciers et qui divise pour mieux régner, pour entrer dans une question de vie ou de mort, que met en lumière la chercheuse. C’est ce qu’exprime par exemple l’héroïne sacrificielle de René Boylesve dansLa Jeune fille bien élevée, qui cède au début du XXème siècle à un mariage arrangé faute d’accomplir dans cette société patriarcale sa vocation de musicienne : Alors, tout à coup, j’eus l’impression que j’étais amenée au mariage comme une bête de somme à l’abattoir.
On y retrouve le même champ lexical que celui qui préside à « l’abattage » des prostituées, livrées à la chaîne aux soldats. Ironiquement, dans tous les cas, la mort physique de la femme n’est évitée qu’au prix de sa mort psychique et identitaire.
Sorcellisation des femmes indépendantes
Ce que donne à voir en miroir l’histoire du roman occidental ainsi contée à travers les tribulations de ses personnages féminins, c’est une misère sexuelle, affective et matérielle si vaste et universellement partagée parmi la diversité des femmes que cela donne le vertige. Toute héroïne romanesque qui chercherait à y échapper ou à brouiller les catégories que l’on voudrait croire étanches serait soumise à un inquiétant processus de sorcellisation
, soit de mise-en-état-de-sorcière
. Indépendante par son savoir, donc non soumise à la loi masculine
, la sorcière est alors diabolisée pour servir d’épouvantail aux lectrices, ou punie pour l’exemple.
La sorcellisation
est bien marginalisation, mise à l’écart. Sorcière
intervient comme un mot magique, stigmatisant, accolé par les auteurs à des personnages de femmes qui n’ont pas nécessairement de pouvoirs fabuleux (la sociologue s’intéresse surtout à des romans dans la veine réaliste) qui sont châtiées pour refuser, ou pour ne pas réussir à rentrer (à cause d’une faute, d’une laideur, d’une malformation, d’une bizarrerie…), dans les rôles assignés aux femmes par le patriarcat [[C’est l’adultère, et l’enfant née de celui-ci, qui fait de Hester Prynne une paria à l’aura de sorcière, obligée de porter sur sa robe un A
symbole de son infamie, dansLa Lettre écarlate de l’Américain Nathaniel Hawthorne (1850). DansSarn de la Britannique Mary Webb (1924), longuement analysé par Heinich, c’est un bec-de-lièvre qui est la raison du rejet collectif de Prue Sarn. Exclue de l’ensemble des femmes vues par la communauté des hommes comme bonnes à marier, elle est faussement accusée de meurtre et traitée en bouc émissaire.]]. Nathalie Heinich fait du mot sorcière la marque des femmes « impatriarcables » (le néologisme est de nous), qui présentent un danger pour l’ordre traditionnel car, montrant une manière de vivre qui s’en éloigne, elles révèlent que ce système n’est pas naturel. Il s’agit donc pour les tenants du système patriarcal d’inverser la charge critique qu’elles représentent, en renvoyant ces femmes à un statut surnaturel, contre-nature, et en les traitant en pestiférées.
Toute femme avec des velléités d’indépendance est-elle donc vouée, bon gré mal gré, à être sorcellisée
, à devenir une sorcière
, si elle refuse de rentrer dans le rang ? Dans la chronologie du roman occidental, on pourrait entrevoir une autre issue possible, une rupture émergente, qui permet aux personnages féminins de s’émanciper des personnages masculins dont elles étaient précédemment condamnées à n’être que les satellites. Une telle indépendance exige plusieurs conditions : la possibilité d’une autonomie financière, liée à une activité personnelle porteuse d’identité plutôt qu’à une situation rentière héritée (…) où l’indépendance n’est plus synonyme de désexualisation
sans compromettre son inclusion dans un réseau de sociabilité
.
Cette rupture avec l’ordre traditionnel gouverné par la loi du père, la sociologue en diagnostique le reflet littéraire dans l’entre-deux-guerres : alors le passage de la fille perdue à la femme libre
, affirme-t-elle [[L’exemple phare relevé par Nathalie Heinich est celui des sœurs Ursule et Gudrun, dansFemmes amoureuses du Britannique D. H. Lawrence (1921), dont les choix amoureux ne sont plus obscurcis par la nécessité de la survie. Il reste malgré tout notable et symptomatique que la narration et même le titre se focalisent sur leurs relations aux hommes plutôt que sur ce qui garantit leur indépendance.]], signe l’implosion du système.
Or, un siècle après ce supposé avènement de la femme libre dans le roman, la prégnance de la prostitution, tant dans la réalité que dans des imaginaires de plus en plus pornifiés, est telle qu’on peut sérieusement douter que ce système ait dans les faits jamais véritablement implosé. Si certaines bénéficient aujourd’hui des conditions suffisantes à leur émancipation et leur épanouissement, combien de femmes vivent toujours sous le règne de l’ordre traditionnel, condamnées à mettre leur sexe à disposition des hommes comme condition de leur survie ?
Grâce à cette lecture, et par le détour du roman, on comprend mieux le malentendu fondamental des débats actuels sur la prostitution. Il n’y a pas de terrain d’entente possible entre, d’une part, ceux et celles qui n’envisagent pas d’autre horizon pour les femmes que l’ordre traditionnel patriarcal et exigent que l’on y soumette de nouveau le droit en érigeant ce système comme principe indépassable de réalité, et d’autre part, celles et ceux qui peuvent imaginer une configuration moderne
, démantèlement définitif de ce système coercitif par la déliaison du rapport de dépendance économique et du rapport sexuel
, qui seule permet de faire éclater l’ordre des états de femme
.




